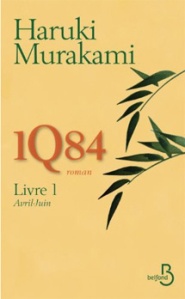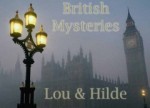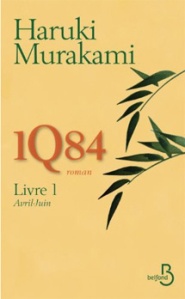
Présentation de l’éditeur :
C’est l’histoire de deux mondes, celui réel de 1984 et un monde parallèle tout aussi vivant, celui de 1Q84. Deux mondes imbriqués dans lesquels évoluent, en alternance, Aomamé et Tengo, 29 ans tous deux, qui ont fréquenté la même école lorsqu’ils avaient dix ans. A l’époque, les autres enfants se moquaient d’Aomamé à cause de son prénom, « Haricot de soja », et de l’appartenance de ses parents à la nouvelle religion des Témoins. Un jour, Tengo l’a défendue et Aomamé lui a serré la main. Un pacte secret conclu entre deux enfants, le signe d’un amour pur dont ils auront toujours la nostalgie.
En 1984, chacun mène sa vie, ses amours, ses activités.

Circonstance de lecture :
Ce roman est dans ma PAL quasiment depuis sa parution. Je l’ai lu cette semaine, entre deux soins à mes chats malades.
Mon avis :
Ai-je aimé ou non ce livre ? Pas suffisamment pour avoir envie d’enchaîner avec le tome 2.
Ce livre est déroutant,il nous plonge dans un univers riche et distordu par rapport au nôtre. Nous sommes en 1984, comme dans le roman de Georges Orwell, référence assumée, mais le monde est différent de ce qu’avait imaginé Orwell, comme le monde imaginé est différent de celui que les lecteurs de 2013 ont connu.
Pour moi, ce livre devrait être lu après Underground , en dépit de l’ordre de traduction en France : Underground a précédé l’écriture de 1Q84, et je suis persuadée que les témoignages recueillis par Murakami sur la secte Aum a influencé le choix de son sujet : il est aussi question d’une secte, repliée sur elle-même, qui n’admet en son sein que des personnes cultivées, déçues par le monde dans lesquelles elles vivent. L’un des personnages est aussi lié à une mouvance religieuse dissidente : Aomamé a eu le courage de fuir les Témoins de Jéhovah, leurs croyances et de quitter ses parents alors qu’elle était toute jeune. Rares sont ceux qui ont autant d’audaces si jeunes… Ceci explique peut-être la construction (solitaire) d’Aonamé, et son métier si particulier, non de tueuse à gages, mais de vengeresse non masquée pour les femmes qui ont eu à subir la brutalité des hommes. Comme si la société japonaise n’offrait aucune réponse légale, judiciaire aux violences faites aux femmes – et que celles-ci n’avaient d’autres échappatoires que la mort ou la violence. Constat sombre ? Oui, indubitablement.
De l’autre côté (dans l’autre monde ?), nous avons Tengo, enseignant, célibataire, une maîtresse qui le satisfait pleinement, un roman en cours d’écriture. En apparence, il est un jeune homme équilibré. En apparence seulement, car lui aussi a subi une enfance dysfonctionnelle, très éloignée de celles de ses camarades de classe. Il devient de plus un écrivain à part puisque sa propre oeuvre est laissée de côté, au profit de la réécriture du première roman d’une toute jeune fille, rescapée (comme Aonamé) d’une secte.
L’écriture et la lecture sont, me semble-t-il un autre thème phare de cette oeuvre, pas seulement à cause d’Orwell, mais aussi à cause de Tchekhov, et de son voyage à l’île de Sakhaline, et des connaissances littéraires de Fikaeri, presque anachronique : elle a appris ces dits en les écoutant, non en les lisant. Paradoxe d’une œuvre écrite qui fait appel à l’ouïe : l’oeuvre débute par une évocation de la Sinfonietta de Janacek, fil rouge musical de ce premier tome.
Ce que je crains pour la suite de la trilogie ? Non le style de Murakami, tout en fluidité, mais des digressions pas toujours intéressantes : les nombreuses aventures sexuelles d’Aonamé, par exemple, ne m’ont pas réellement intéressées. Et telle que je me connais, il faudra au moins un an avant que j’ouvre le tome 2.

 Je vous rassure tout de suite : je ne suis pas en train de créer un nouveau challenge, non. La preuve : ce logo m’est totalement personnel.
Je vous rassure tout de suite : je ne suis pas en train de créer un nouveau challenge, non. La preuve : ce logo m’est totalement personnel.