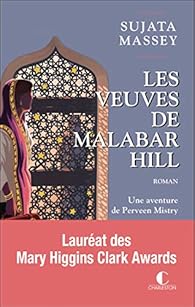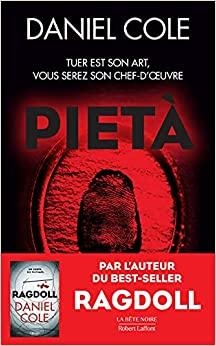édition Rageot – 160 pages
Présentation de l’éditeur :
Judokate mondialement connue, Clarisse Agbégnénou nous raconte ici sa jeunesse jusqu’à son premier titre mondial, à 21 ans. De sa naissance à son entrée au club d’Asnières à 9 ans, nous la suivons au sein de sa famille. Jugée turbulente par ses enseignants, elle choisit de faire du judo pour canaliser son énergie. Remarquée pour ses qualités athlétiques, elle brûle les étapes pour obtenir ses ceintures et survole ses concurrentes dans toutes les compétitions. Dès 14 ans, Clarisse entre au Pôle France d’Orléans, antichambre de l’INSEP qu’elle intègre trois ans plus tard. Elle devient championne d’Europe dans la foulée ! C’est le début d’une incroyable réussite à la fois sportive et humaine…
Merci aux éditions Rageot et à Netgalley pour leur confiance;
Mon avis :
Petit avertissement simple : je ne suis pas sportive, je ne connais que peu de choses au judo, même si l’un de mes cousins a pratiqué ce sport pendant de longues années. Cela ne m’a pas empêché d’aimer la lecture de ce livre, qui ne s’adresse pas qu’aux sportifs et qui, surtout nous parle avant tout d’être soi, d’oser être soi, et non de rentrer dans la norme.
Clarisse Agbegnenou retrace son parcours, de sa naissance prématurée à son premier titre mondial. Chaque chapitre représente une étape et se clôt par un bilan, par des conseils, bref, par la volonté d’aider son lecteur à trouver sa voie. La première clé est de prendre du plaisir, quel que soit l’activité pratiquée. C’est une notion qui est trop facilement oubliée par, eh bien par les adultes (pas tous, heureusement) comme si une activité n’avait de valeurs que parce qu’elle faisait souffrir. La seconde clé, c’est la persévérance, se souvenir de ce que l’on veut vraiment. Oui, il faut faire des choix, et certains ne sont pas faciles, certains ne seront pas compris par les amis, voire par le petit ami. Et cela nous emmène vers ce que j’ai appelé la troisième clé : être bien entouré(e). Oui, j’ai l’impression d’enfoncer une porte ouverte, mais combien de petits amis ne sont pas prêts à passer après la passion de leurs petites amies ? Très peu. C’est très souvent la jeune fille qui est obligée de se sacrifier pour le jeune homme, parce que celui-ci (et beaucoup de personnes avec lui) pensent que les passions d’un garçon valent plus que celles d’une fille. J’ajoute, pour ceux qui sont « fleur bleue », qu’il en est qui pense que l’amour vaut tous les sacrifices. Justement : si l’on aime une personne, on est heureux de la voir s’épanouir dans une discipline qu’elle aime.
Il est d’autres sujets tout aussi importants qui sont abordés dans ce livre : le racisme, le rapport au poids et à la nourriture. « Si un jour, j’ai un enfant, je ne lui mettrai jamais la pression sur son poids. Heureusement que je suis bien entourée, mais j’ai vu des filles s’affamer pour être dans la catégorie inférieure… Les adultes ne se rendent pas compte du poids de leurs paroles… » Ses phrases ont résonné en moi, parce qu’il est important de rappeler aux filles (oui, toujours elles) que leur valeur ne dépend pas d’un chiffre sur une balance.
N’allez pas croire cependant que le livre soit rébarbatif à lire, bien au contraire. Ce récit est au contraire très positif, montrant comment persévérer, surmonter les obstacles, non pour rentrer dans la norme, mais pour être véritablement soi.


 Mon avis :
Mon avis :