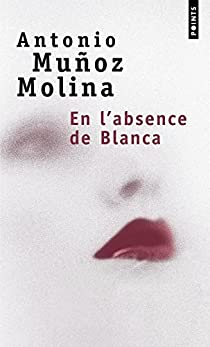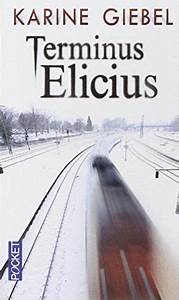Présentation de l’éditeur :
Anna, Milena et Henrik ont depuis longtemps une tradition bien à eux : tous les ans, ils partent randonner dans le nord de la Suède. Lorsque Milena convie son petit-ami Jacob à se joindre à eux, ses amis acceptent, malgré de premières réticences. Anna en est persuadée : elle a déjà vu Jacob quelque part. Mais où, et à quelle occasion ? Les quatre promeneurs débutent leur périple, quand Jacob propose un changement de plan : s’éloigner du chemin balisé pour se rendre sur les chemins solitaires et plus âpres de Sarek, l’un des parcs nationaux les plus somptueux de Suède. Une décision qui pourrait bien changer le cours de leur vie à jamais.
Merci aux éditions de la Martinière et à Netgalley pour ce partenariat.
Livre lu le 7 mars 2023.
Mon avis :
Le polar suédois offre des oeuvres d’une grande diversité. Témoin, le premier roman d’Ulf Kvensler, acteur, scénariste et réalisateur suédois.
Dès le début du roman, nous savons que quelque chose de grave est survenu. Mais quoi ? Nous avons cependant, à travers la retranscription d’un interrogatoire de police, des pistes sur ce qui est survenu. Mais revenons en arrière et suivons les pas d’Anna. Elle est en couple depuis dix ans avec Henrik et, au cours de retours en arrière, nous découvrirons comment ils se sont rencontrés. Elle semble avoir une bonne situation professionnelle, en tout cas, elle est très investie dans son travail, ce qui ne l’empêche pas de pratiquer du sport régulièrement. Elle a une meilleure amie, Milena, et justement, cette meilleure amie lui présente Jacob, et c’est un événement : jamais Milena ne lui avait présenté un de ses petits copains en dix ans ! Milena tient à ce que Jacob les accompagne tous les trois dans leur traditionnelle randonnée annuelle. Sauf que Jacob a décidé de bousculer leurs plans : ils ne suivront pas leur itinéraire habituellement mais se rendront dans le parc national du Sarek.
Pour les autres lecteurs, je ne sais pas, pour ma part, j’ai eu de nombreux clignotants qui se sont allumés au fur et à mesure de la lecture de ce récit. Nous suivons uniquement le point de vue d’Anna (du moins, pendant la majorité du récit) et nous devons nous fier à son opinion, son ressenti. Cependant, je me suis souvent demandée pourquoi elle ne voyait pas certaines choses, pourquoi elle ne voyait pas, et ce, dès le début, à quel point son conjoint, Henrik, allait mal. Il faut dire qu’à Anna, tout lui réussit, alors elle ne supporte pas que lui se laisse aller – à ses yeux – alors qu’aux miens, je voyais les symptômes au moins d’une grosse déprime, pour ne pas dire une dépression. Je me demandais alors si Anna ne voyait rien, ou si elle ne voulait pas voir, elle qui, durant les premiers temps de leur traditionnelle randonnée, constate qu’elle marche devant, et que son conjoint peine à suivre. Ne lui demandez pas de l’attendre, même si, parfois, elle sera bien obligée de le faire, voire de revenir en arrière, quand elle ne le tance pas vertement. J’avais l’impression que les rôles traditionnels étaient inversés, et qu’Anna cochait quasiment toutes les cases de la masculinité toxique – aussi, quel contraste avec les scènes d’interrogatoire, dans lesquelles elle apparaît affaiblie, effondrée par les épreuves qu’elle a traversées. Quel contraste aussi, avec ce que l’on découvrira de son passé, et qui éclairera d’un jour nouveau sa personnalité.
C’est à ce moment de l’écriture de mon avis que je vous conseille de lire ce livre chez vous, dans un endroit bien chaud, avec aussi, si possible, des boissons chaudes à disposition. Parce que ce que traversent Anna et Henryk tient vraiment d’un épisode d’une émission type « l’homme face à la nature ». Je me plains parfois que certains romans ne nous permettent pas vraiment de découvrir le pays où se passe l’action, là, je peux dire que je me suis vraiment trouvée au plein coeur de la Suède, une Suède sauvage, loin de tout ce qui peut faire le confort moderne, une Suède dans laquelle on ne peut se rendre sans une ample préparation et sans une attention de tous les instants.
Que s’est-il vraiment passé à Sarek ? Je doute que le lecteur le sache vraiment, même après avoir refermé ce livre.



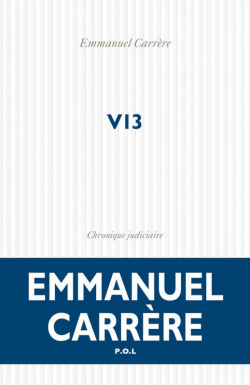 Présentation de l’éditeur :
Présentation de l’éditeur :