
Présentation de l’éditeur :
Jeune fille coincée dans un corps de garçon qu’elle ne sait habiter, la narratrice de La Mauvaise Habitude retrace son parcours, de son enfance dans les années 1980, où elle grandit dans une famille ouvrière de San Blas, un quartier populaire madrilène dévasté par l’héroïne, à ses nuits clandestines au coeur du Madrid des années 1990. Telles la Margarita, diva fanée qui hante le quartier, la fière Moraíta à la sauvagerie de chimère, ou la Cartier, toujours parée de ses rutilants bijoux de pacotille, nymphes triomphantes et anges déchus l’accompagnent dans son odyssée personnelle.
Une odyssée envers et contre l’asphyxie des faux-semblants, la lâcheté et la violence qui la guettent à chaque pas, pour apprendre à exister en habitant sa propre légende et marcher la tête haute.
Mon avis :
Ceci est ma deuxième lecture pour le mois espagnol, et j’ai l’impression qu’elle risque de marquer le coup d’arrêt de mes lectures espagnoles (heureusement, il me restera les lectures sud-américaines). En effet, cette lecture a été une vraie souffrance, et je n’aime pas quand lire un livre me fait souffrir. Note : l’autrice a bien sur nettement plus souffert que moi, je soupçonne hélas ce livre d’être autobiographique.
Actuellement, en France, les médias donnent beaucoup la parole aux personnes transphobes (oui, j’ai des noms en tête). En revanche, pour donner la parole aux personnes trans… on peut toujours attendre. La narratrice sait, depuis toujours, qu’elle est une fille, puis une femme. Son corps lui dit autre chose. Elle grandit dans un quartier pauvre de Madrid, quartier qui semble à des années lumières de Madrid même, tant les pouvoirs publics se moquent allègrement de ceux qui y vivent et surtout, de ceux qui y meurent. La violence est omniprésente, j’ai eu l’impression que personne n’essayait de faire quoi que ce soit pour que cela change. Tout ceux qui le peuvent, au contraire, usent de leur petit pouvoir pour faire un petit peu de mal, jour après jour, notamment renvoyer l’autre, celle qui est différente, à son identité « génétique », à ce « monsieur » qui est inscrit sur sa carte d’identité. L’on attend des personnes trans qu’elles soient irréprochables. Note : trente ans après, c’est toujours ce que l’on attend des personnes trans et des personnes homosexuelles, comme si elles n’étaient pas avant tout des êtres humains comme les autres.
Au cours de ce récit, j’ai croisé des personnes fortes, des personnes qui ont souffert, des personnes, aussi, qui ont accompagné la narratrice qui a vécu énormément de temps dans un placard, portant un masque pour dissimuler qui elle était vraiment, tâchant d’adopter le comportement que l’on attendait d’elle, c’est à dire, aux yeux de la société, de lui. Le pire a été sans doute de me dire, en lisant ce récit, que l’attitude de trop nombreuses personnes n’a pas tant changé que cela, trente ans après.
La mauvaise habitude est un récit très intéressant, mais véritablement très dur (et c’est une personne qui n’a pas une sensibilité exacerbée qui vous le dit).
Je précise que cette chronique a été écrite avec Grisette sur mes genoux, Roselyne à ma gauche, et Lisette qui m’a sautée dessus.




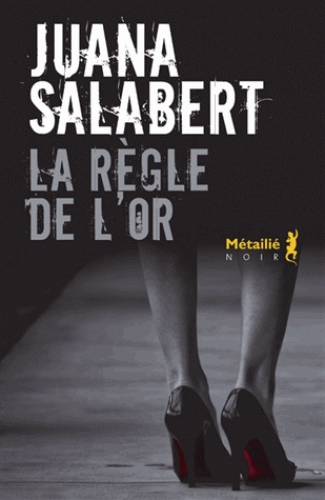

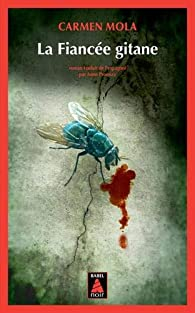

 Présentation de l’éditeur :
Présentation de l’éditeur : 



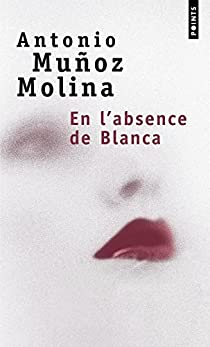

 Présentation de l’éditeur :
Présentation de l’éditeur : 