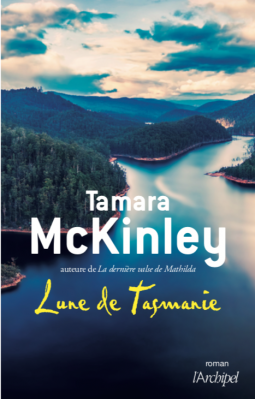édition Mera – 440 pages
Présentation de l’éditeur :
Surnommé par les médias « le meurtre de la colocataire », l’affaire trouble les Australiens depuis près d’une décennie. Olive Groves, journaliste au Melbourne Today, a couvert les faits à l’époque jusqu’à l’obsession. Neuf ans plus tard, lorsqu’une des colocataires est retrouvée morte dans une maison isolée. Oli est de nouveau chargée de l’affaire, mais cette fois, c’est à contrecœur qu’elle doit faire équipe avec Cooper, un jeune podcasteur. Tandis qu’Oli et Cooper exhument de nouveaux faits, de sombres secrets sont mis au jour. Les révélations propulseront Oli dans le passé, la contraignant à affronter ses propres démons.
Que s’est-il réellement passé entre les trois colocataires cette nuit-là ? La quête incessante d’Oli pour la vérité mettra-t-elle sa nouvelle famille en danger ? Et sa conviction que le meurtrier se trouve au plus près de chez elle pourrait-elle menacer son bonheur et même sa santé mentale ?
Mon avis :
La colocataire est un roman que j’ai apprécié de plus en plus au fur et à mesure de la lecture. Passé la moitié du récit, il montait vraiment en puissance, gagnant page après page en force et en émotion. La construction de l’intrigue est véritablement très minutieuse : les indices qui nous mènent vers le dénouement sont là, pourtant, et nous ne les voyons pas nécessairement. L’autre point fort est que les personnages sont tous profondément humains, c’est à dire riches, complexes, nous ne sommes pas face à des caricatures ou à des êtres manichéens.
Prenons Oli, le personnage principal, celle à travers laquelle nous voyons tout ou presque. Elle a tout pour être heureuse. Sa carrière de journaliste est réussie, elle est en couple avec l’homme qu’elle aime, et c’est réciproque, elle a deux petites filles et … Et rien n’est simple. Ses filles sont les filles nées du premier mariage de leur père, mariage qui s’est terminée par l’assassinat de sa première femme, Isabelle, enquêtrice charismatique, tuée par un homme qu’elle avait mis en prison et qui avait été libérée depuis. Isabelle était chargée de l’enquête sur « le meurtre de la colocataire », dont la mort n’a pas été totalement élucidée.
Et, aujourd’hui, un coup de théâtre se produit qui remet l’affaire sous les feux des projecteurs. Olive est à nouveau chargée de couvrir l’affaire, si ce n’est qu’en dix ans, elle n’est plus la jeune journaliste manquant d’expérience, et qu’elle se voit adjoindre Cooper, un jeune homme passablement agaçant, podcasteur de son état. Grâce à eux, nous suivrons pas à pas le métier de journaliste, les méthodes que certains emploient pour parvenir à avoir la primeur des informations, les bâtons dans les roues que l’on peut leur mettre aussi. Puis, être journaliste, c’est aussi être confronté à l’humain, certains n’ont pas envie de parler, n’ont plus envie de parler, de répéter, encore et encore, ce qu’ils ont vu, vécu, tout le monde n’as pas envie d’être sous le feu des projecteurs, alors que certains ne demandent que cela. L’on voit aussi les liens entre les journalistes et la police, liens qui peuvent être très forts, comme celui qui unit, dans le bon sens du terme, Oli et Rusty, peut-être aussi parce qu’ils partagent le même but : la quête de la vérité.
L’un des thèmes fort de ce roman est la dénonciation des violences faites aux femmes et aux enfants. C’est malheureusement un thème intemporel, tout comme il est intemporel de montrer que certain(e)s ne voient pas ce qui se passe sous leurs yeux, ce qui se passe tout près d’eux, et quand on a vécu cela, quand on a vécu cet aveuglement involontaire, l’on se rend compte que l’on se doit d’être véritablement vigilant face à ce qui vous entoure, face à ce que les autres disent, font, face à cette belle image qu’ils montrent d’eux. Non, je ne parle pas pour moi, je parle pour un des personnages du récit. Etre vigilant sauve des vies, ou tout du moins modifie leurs cours. C’est peut-être en cela que notre société évolue : dans les romans, on présente de moins en moins des personnages qui attendent, qui laissent les choses passer ou remettent à demain, ce qui, dans les récits romanesques, provoquent toujours des catastrophes. Ici, si catastrophes il y a (et il y a) ce n’est pas faute d’avoir agi, d’avoir tenté, ou d’être intervenu.
Un coup de coeur ? Oui, certainement.
Merci aux éditions Mera et à Netgalley pour ce partenariat.
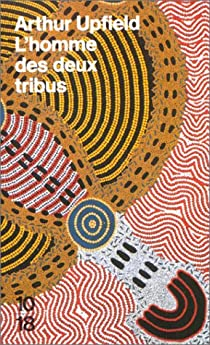



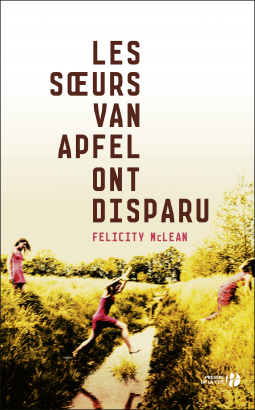 Présentation de l’éditeur :
Présentation de l’éditeur :