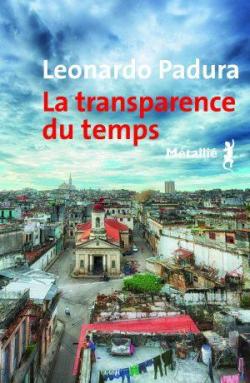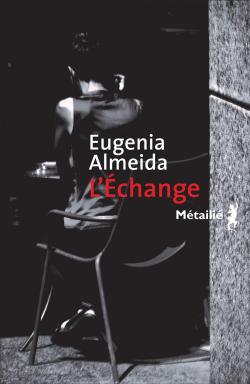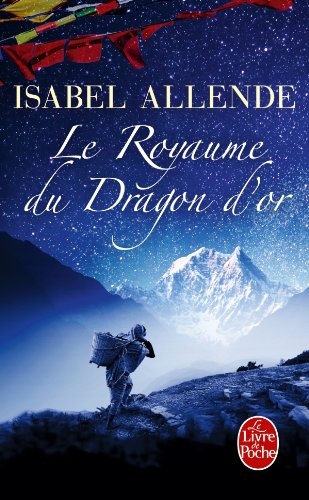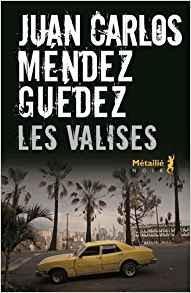édition Métailié – 240 pages
Mon avis :
Merci aux éditions Métailié et à Netgalley pour ce partenariat.
J’ai déjà évoqué ma difficulté à lire de la littérature brésilienne. Je crois que ce livre marque une étape, parce que je l’ai vraiment beaucoup apprécié. Il s’agit d’un premier roman, qui joue avec la temporalité : nous suivons en effet Ana qui, après la mort de sa mère, rejoint son père archéologue dans le Xingu. Elle vivra avec lui au sein d’une tribu indienne. Avec elle, nous découvrons leur mode de vie, leurs rites, leur manière très différente de la nôtre d’appréhender le corps humain, mais aussi la nature. Certaines coutumes peuvent étonner, choquer même – et Ana de comparer la manière dont elle vit et la fille du chef vivent leur adolescence. L’une est libre de découvrir le village, la nature, l’autre vit recluse pour un an, cela fait partie du rite d’initiation pour devenir une femme. Rien pourtant de lourd ou de didactique dans ce récit : comme Ana, le lecteur est immergé dans cette tribu. Ni les uns ni les autres ne portent de jugement sur leur mode de vie mais Ana découvrira la richesse, la profondeur de leur culture, la culture que certains appellent encore des sauvages.
Oui, nous retrouverons Ana adulte, étudiante à la Sorbonne. Nous découvrons comment elle a quitté le Xingu, coupé les ponts aussi, presque malgré elle avec son père, nous découvrons aussi comment elle renoue avec son passé, en retournant là-bas, en découvrant les ravages commis par ceux qui pensent d’abord aux profits avant de penser à la vie. Cette dernière partie m’a semblé plus brève que les précédentes, peut-être aussi parce qu’elle est davantage centrée sur les sentiments d’Ana, sur sa vie à Paris et ce sentiment d’inachevé qu’elle ressent. J’aurai aimé que les retrouvailles durent plus longtemps, que l’on voit ce qui avait changé au sein de la tribu. Ce n’est pas un reproche, cela montre simplement à quel point j’ai apprécié la lecture de ce livre.
Un premier roman à découvrir.